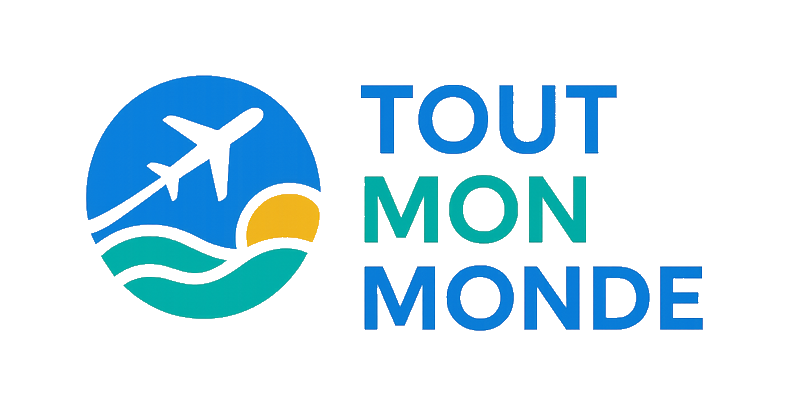Les mêmes pays ne se retrouvent jamais tous ensemble au sommet des classements internationaux, peu importe la précision des critères choisis. La Finlande brille sur le plan éducatif, la Suisse s’impose en matière d’innovation, mais aucune nation ne rafle systématiquement la mise dans chaque registre analysé.
Un décalage subsiste entre ce que l’opinion imagine et ce que révèlent les chiffres, amplifié par la diversité des méthodes employées selon chaque organisme. Les hiérarchies évoluent au gré des critères retenus, redistribuant chaque année les meilleures places et bousculant les certitudes. Impossible de couronner un modèle unique, tant la réalité échappe à toute standardisation.
Quels critères déterminent qu’un pays est considéré comme le plus avancé ?
Définir le pays le plus avancé au monde implique de jongler avec une palette de critères, sélectionnés différemment selon les institutions. Le classement mondial ne repose plus seulement sur la taille du PIB. Aujourd’hui, on dissèque l’état d’avancement par une série d’indicateurs de développement : percées technologiques, qualité de vie, solidité des institutions, et bien d’autres encore.
Le rapport sur le développement humain, émanant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), privilégie l’Indice de développement humain (IDH). L’espérance de vie, le niveau de formation et le revenu par tête sont additionnés pour brosser un portrait plus fidèle des sociétés. Ce n’est qu’une facette de l’évaluation.
Le Global Innovation Index (GII), produit par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et le Portulans Institute, propose une lecture spécifique et complète du progrès. Avec la validation de la Commission européenne, ce classement ausculte 78 indicateurs. Voici ce que l’analyse couvre :
- production créative
- demandes de brevet
- investissements en R&D
- infrastructures
- indicateurs économiques
- capacités d’innovation
Ces axes reposent sur des données économiques, scientifiques et technologiques, en y ajoutant les marqueurs de la propriété intellectuelle. Soumitra Dutta et Bruno Lanvin, à l’origine du GII, insistent sur la pluralité des sources, garantissant une vision globale du progrès.
Les grandes agences internationales, telles que la Banque mondiale et les institutions européennes, apportent aussi leur lot de statistiques. On retrouve dans leurs rapports la part réservée à la recherche, à la diffusion des technologies, ou à la connectivité des infrastructures. Chaque édition du rapport mondial sur le développement affine la cartographie des nations les plus dynamiques et met en lumière la diversité des trajectoires.
Classements internationaux : panorama des performances en éducation, innovation et développement humain
Les classements internationaux offrent un aperçu inédit du jeu mondial des puissances. La Suisse caracole en tête du classement GII 2024, fidèle à sa réputation de laboratoire à idées neuves. Elle est suivie de près par la Suède, les États-Unis d’Amérique, Singapour et le Royaume-Uni : cinq pays où s’entremêlent excellence académique, dynamisme entrepreneurial et avancées technologiques.
La France s’installe à la 12e place, devant le Japon, tout en restant parmi les leaders du continent européen. Quant à la Chine, elle se distingue à la 11e position, seule économie à revenu intermédiaire à se hisser aussi haut, illustration d’un basculement progressif vers l’Est en matière d’innovation. Les Pays-Bas occupent la 7e place, preuve d’un tissu scientifique particulièrement dense et efficace.
Mais l’innovation n’est pas le seul terrain d’évaluation. Les résultats des études PISA menées par l’OCDE sur l’éducation offrent d’autres perspectives, où les pays nordiques et asiatiques tiennent la corde. Voici un aperçu des enseignements tirés de ces enquêtes :
- Singapour se distingue dans les mathématiques et les sciences.
- La Finlande propose un modèle scolaire où équité et accompagnement priment.
Du côté de la recherche scientifique, le pôle Tokyo-Yokohama s’impose par sa taille, tandis que Cambridge affiche une densité d’activités sans équivalent. D’autres régions tirent leur épingle du jeu : Israël domine en Afrique du Nord et Asie occidentale, Maurice s’affirme pour l’Afrique subsaharienne, Brésil en Amérique latine, et Inde en Asie centrale et du Sud.
Ce croisement entre développement humain, performance scolaire et innovation met en avant les stratégies nationales qui dessinent l’avenir, explorant bien plus qu’un simple podium.
Enjeux et impacts de ces classements sur les politiques publiques et la société
À chaque publication du classement mondial, le débat public s’anime. Les gouvernants, d’un bout à l’autre du globe, scrutent la moindre évolution, la plus petite nuance méthodologique. Derrière ces indicateurs, qu’il s’agisse de développement humain (IDH), de PIB réel ou du rythme des publications scientifiques, se dessinent des leviers concrets pour réorienter les priorités nationales. À Paris, Berne ou Singapour, l’enveloppe des financements publics dépend souvent de ces baromètres internationaux.
Les dernières analyses du GII mettent en lumière des tendances en contraste : alors que les investissements mondiaux en R&D atteignent un record en 2022, la dynamique du capital-risque et des publications ralentit en 2023. Cela interroge : comment préserver la dynamique d’innovation dans un contexte économique incertain ? La société civile s’empare elle aussi de ces classements pour interpeller les décideurs sur les choix à opérer, que ce soit en matière d’éducation ou de cohésion sociale.
L’entrepreneuriat social s’impose peu à peu comme une pièce maîtresse dans le débat sur la croissance. L’Indice mondial de l’innovation le reconnaît désormais comme moteur à part entière. Cette nouvelle donne pousse les universités, les entreprises et les organisations de la société civile à travailler main dans la main pour répondre aux défis sociaux et environnementaux.
En fin de compte, la rivalité entre pays ne se résume plus à une course aux chiffres. Ces rangs, ces données, deviennent des outils pour questionner l’efficacité des politiques, revisiter la formation des talents, et stimuler la création de valeur collective. À travers eux, c’est toute une société qui se redéfinit, cherchant constamment à se projeter au-delà des résultats et à façonner un avenir qui n’appartient à personne d’autre qu’à ceux qui osent le réinventer.